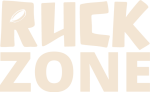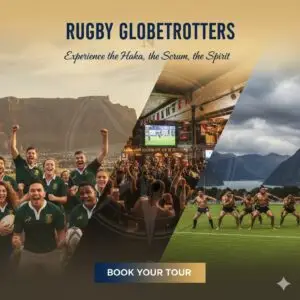Le 15 octobre 2023, le Stade de France retient son souffle : le XV de France, hôte et espoir national, s’incline d’un point (28-29) face aux Springboks, futurs champions du monde deux semaines plus tard. Une déflagration ! Deux ans après et à l’aube de retrouver les bourreaux Springboks (samedi 8 novembre), ce quart de finale reste une blessure collective, dans toute l’ovalie. Plus qu’un simple revers sportif, mais un récit qui continue de travailler les consciences et la mémoire du rugby français.
Il y a des défaites qui s’effacent, d’autres qui s’inscrivent en creux. Celle-là appartient à la seconde catégorie parce qu’elle concentre plusieurs ingrédients d’une douleur durable : l’enjeu maximal – une Coupe du monde jouée à domicile -, la brutalité dramatique du scénario – un chassé-croisé haletant – et l’impression tenace d’un rendez-vous manqué ou volé arraché à la gorge d’un public qui n’a jamais quitté son siège. Le spectacle fut à la hauteur de la tragédie ; la chute, d’autant plus cruelle, que les Bleus avaient souvent mené au score. Cet échec si ténu est devenu bien plus qu’une défaite : un traumatisme collectif, un récit suspendu, et une cicatrice ouverte dans la mémoire du rugby français.
Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud
« C’était notre rêve à nous aussi »
On a beau avoir revu ces actions, analysé, décrypté, trouvé des explications à ce cauchemar, et tenté de passer la pommade sur le déchirement du scénario… Tout comme les joueurs l’ont fait. La page est tournée, mais le livre ne l’est encore tout à fait. Le monde amateur, qui vibre au rythme des performances du XV de France, accuse encore le coup. « Il y a la finale de 2011, mais celle-là… Elle restera en travers de la gorge à vie, vraiment à vie, avec encore plus d’intensité, regrette Mathieu Pennezzi, joueur de fédérale à côté d’Aurillac. C’était notre rêve à nous aussi. Il n’y avait pas que 23 bleus sur le terrain, mais tout un pays. Il y avait tout pour la gagner…«
🏉🇫🇷 FLASH – Le #XVdeFrance est éliminé de la Coupe du monde de rugby après sa défaite 28 à 29 face à l’Afrique du Sud. #FRAvRSA pic.twitter.com/Vg1z9PJgQH
— Mediavenir (@Mediavenir) October 15, 2023
Sur le plan affectif, la défaite a germé dans la proximité. Joueurs, staff et supporters partageaient un horizon commun : faire de 2023 l’année d’un accomplissement national. Lorsque ce projet s’est envolé d’un souffle – un point, un coup de pied, une (ou plusieurs) décision arbitrale contestée – la déception n’a pas seulement touché des sportifs, elle a touché une nation qui avait investi ses rêves dans le maillot. Les confessions publiques des capitaines et des entraîneurs, la voix cassée en conférence de presse, ont prolongé cette narration du manque. Encore aujourd’hui, quand les joueurs eux-mêmes qui ont vécu ce déchirement en reparlent. Les propos de Labit ou Ramos de ces derniers jours vont dans ce sens…
« Dramatique et cruel »
Politiquement et culturellement, le rugby en France occupe une place singulière : sport de « corps », de combat, mais aussi de sociabilité, il sert de miroir aux attentes collectives. Perdant à domicile, le récit s’est mué en interrogation : que faut-il revoir ? Quelle injonction au changement ? Les éditoriaux et la presse étrangère n’ont pas manqué de saisir le caractère « dramatique et cruel » du match, rendant l’écho plus universel et la blessure moins privée. Deux ans passés et avant de retrouver les « Bocks » ce samedi (8 novembre, 21 heures), le traumatisme resurgit. Dans une salle de sport d’Aurillac, où s’entrainent les joueurs d’Arpajon-sur-Cère et de Saint-Simon, le dossier ressort. « Il y a comme une forme de tension à l’approche de ce match… Le regarder ne sera pas simple, ça rappelle un chagrin et une tristesse d’un rendez-vous manqué« , peut-on entendre. « Il y a quasiment les mêmes joueurs sur le terrain en plus.«
La Fédération internationale de rugby reconnaît 5 “erreurs majeures” d’arbitrage lors de France – Afrique du Sud 🏉 pic.twitter.com/lsRLfBmTQw
— Views (@viewsfrance) October 20, 2023
Enfin, il y a la mémoire sportive : elle se nourrit de séquences, d’images – le silence du stade, la détresse des joueurs, les commentaires en boucle – et se réactive lors des anniversaires, des « commémorations » ou des épisodes qui rappellent ce soir-là. Quand les mêmes joueurs, ou leurs successeurs, reviennent sur le terrain, l’événement ressurgit, non comme une page tournée, mais comme une empreinte. Les analyses rétrospectives, parfois vives, insufflent un sentiment d’inachevé qui rend la reconstruction plus lente et plus exigeante.
« Il arrive de parler de ce match à l’école de rugby avec les jeunes… Pour les plus petits, il fera date »
Éric Morzine, éducateur
La frustration française gagne en relief lorsqu’on jette un œil sur les zones d’ombre qui gravitent autour des Sud-Africains. Plusieurs joueurs sud-africains ont été sanctionnés ou mis en examen pour dopage : Aphiwe Dyantyi, ancien ailier des Springboks, a ainsi été suspendu quatre ans après un contrôle positif à plusieurs stéroïdes anabolisants. L’ex-ouvreur, Elton Jantjies, a écopé d’une interdiction de quatre ans après avoir été contrôlé positif au clenbutérol en 2023. Plus récemment, Asenathi Ntlabakanye a fait l’objet d’un « adverse analytical finding« (trouvaille analytique adverse) porté par l’organisme sud-africain antidopage, alors qu’il avait déjà été aligné avec les Springboks. Cette accumulation de scandales pourrait attiser une certaine forme de rancune sourde. Pour les supporters du XV de France comme pour toute la communauté rugbystique française, perdre contre une sélection pudique dans ses triomphes, mais entachée par ces affaires, laisse certainement un goût amer.
#ENGvRSA
— Cédric (@Inimre) October 21, 2023
Ben O'Keeffe offre la finale aux Sud Af, pitoyable… pic.twitter.com/8V9K7Xd97h
Se remettre n’est pas seulement corriger des automatismes tactiques ; c’est aussi réapprendre à transformer la blessure en moteur. Pour les Bleus, la route est longtemps passée par une parole tue, avant une lecture lucide des erreurs et un travail patient sur l’imaginaire collectif : convertir la frustration en récit d’un futur possible. Tant que le « pays » continuera de relire ce quart de finale comme une promesse volée, la douleur restera vive, mais elle peut, si on la travaille, devenir la matière première d’un projet renouvelé. « Il arrive de parler de ce match à l’école de rugby… Les plus jeunes posent des questions, sur le scénario, l’arbitrage, le contexte, concède Eric Morzine, éducateur de rugby du côté de Clermont. Même pour les petits, ce match fera date. Un moment qui forgera leur évolution et leur devenir de rugbymen (rugbywomen). »
Réparer et reconstruire
Le récit continue, car c’est souvent dans une blessure qu’on forge une caractéristique. Le challenge pour le XV de France a été et est encore aujourd’hui de ne pas laisser cette cicatrice se refermer sur elle-même, mais de la convertir en suture ouverte, volontaire, signe d’un avenir. Finalement, on ne saura jamais exactement l’impact de cet échec, puisqu’il s’agit bien d’un échec, sur les joueurs du XV de France. Mais pour une partie des acteurs du monde amateur aujourd’hui, le cœur du problème n’est pas seulement la défaite, mais l’impossibilité apparente de la digérer. Elle reste parfois comme une ombre portée, dans les entraînements, les choix, les regards. Le challenge est double : réparer et construire.
Cette défaite d’un point n’est pas derrière eux, derrière nous : elle est à côté, à portée de main, comme une marée qui n’a pas encore tout rendu. Se remettre ne consiste pas simplement à passer définitivement à autre chose. Cela signifie regarder la mer, relever ce qu’elle nous a pris, et décider, ensemble, de rebâtir sur ce sable mouvant. Deux ans, et un Six Nations dans l’armoire plus tard, le chemin est pris. « Il faut parfois regarder derrière pour aller de l’avant« , a confirmé Fabien Galthié, en conférence de presse, ce jeudi, au moment d’annoncer les 23 qui défieront samedi soir… les Springboks.